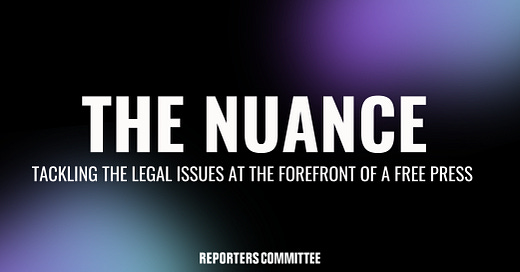👁🗨 Assange tente un nouveau recours au Royaume-Uni
L'Espionage Act ne fixe pas le champ d'application suggéré par Washington mais le gouvernement trouvera toujours le moyen de qualifier de grave toute fuite affectant soit-disant la Sécurité nationale.
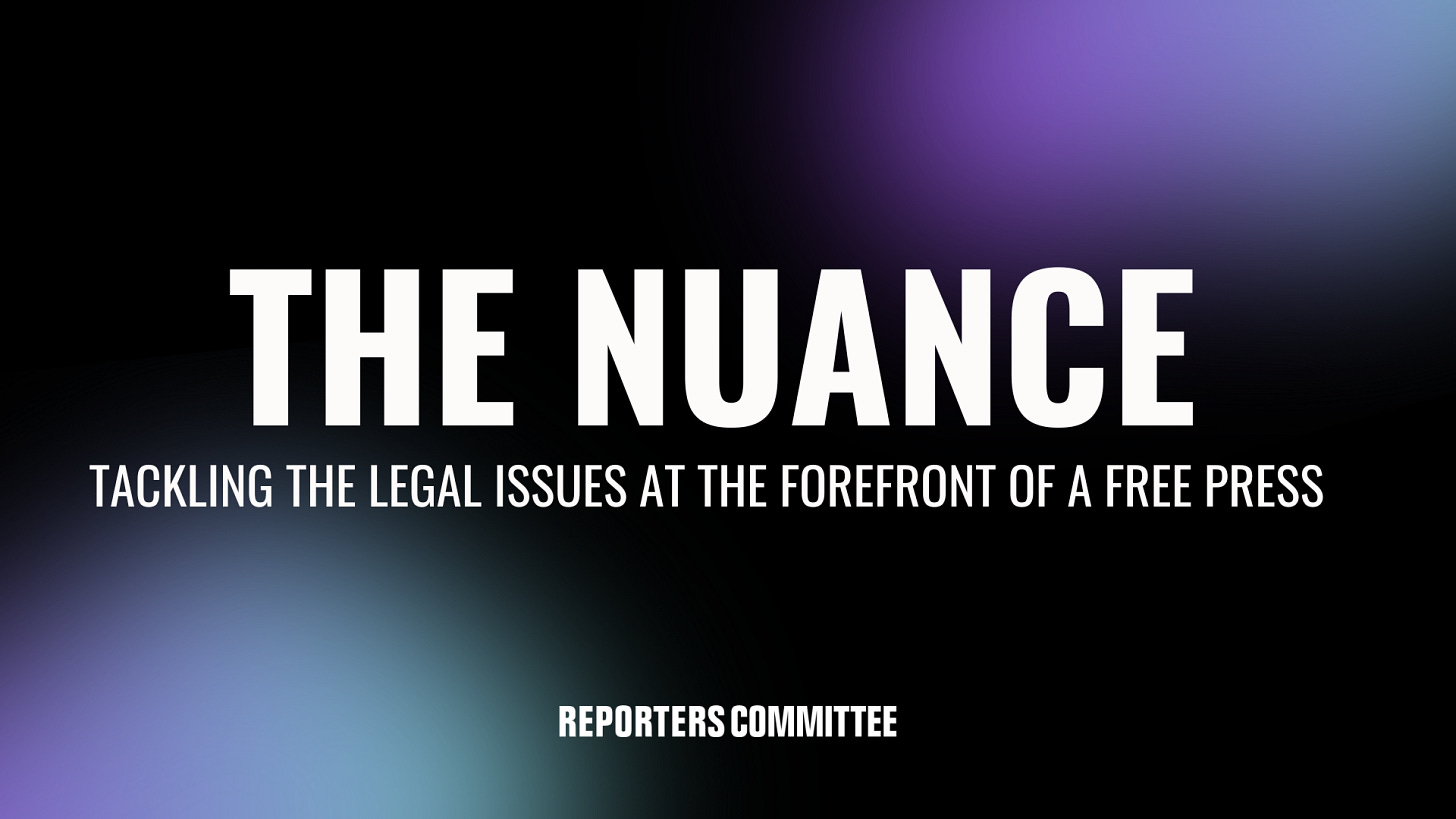
👁🗨 Assange tente un nouveau recours au Royaume-Uni
Par Gabe Rottman, le 26 février 2024
Gabe Rottman, du RCFP, explique pourquoi l'un des arguments du gouvernement américain dans l'affaire Julian Assange est si préoccupant.
Mardi et mercredi derniers, un panel de deux juges de la High Court britannique a entendu les arguments du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, dans sa tentative de bloquer son extradition vers les États-Unis sur la base d'accusations liées à l'Espionage Act et à la criminalité informatique.
La question technique qui se pose à la Cour est de savoir si Julian Assange peut faire appel, après qu'un juge unique de la High Court a déclaré qu'il ne pouvait pas le faire en juin 2023. Si la Cour confirme la décision de juin, M. Assange aura épuisé tous les recours devant les tribunaux britanniques (bien qu'il ait déclaré qu'il continuerait à contester l'extradition devant la Cour européenne des droits de l'homme). Et si la High Court donne raison à M. Assange, elle organisera d'autres audiences pour examiner les questions de fond en jeu. La Cour a mis son jugement en délibéré, et la date d'une éventuelle décision n’est pas encore fixée.
D'après les rapports publics, il ne semble pas qu'il y ait eu beaucoup de surprises. M. Assange continue de soutenir que la criminalisation de la réception et de la publication de secrets gouvernementaux constituerait une atteinte au Premier Amendement. Nous avons depuis longtemps souligné nos graves préoccupations concernant les trois chefs d'accusation pour “publication pure” retenus dans l'acte d'accusation, qui inculpent Assange directement en vertu de l'Espionage Act (loi sur l'espionnage) pour le seul fait d'avoir publié des secrets d'État en ligne. C'est la première fois que le gouvernement obtient un acte d'accusation d'un grand jury sur la base de ce critère.
En outre, l'avocat des États-Unis continue de marteler une autre affirmation troublante : cette affaire ne concerne en réalité que la publication par Assange et WikiLeaks des identités non expurgées de sources ayant fourni des informations aux États-Unis.
Selon la BBC, l'un des avocats des États-Unis, Clair Dobbin KC, a déclaré à la Cour :
“Il ne s'agit pas là d'un impair ou d'une bévue, mais de la publication d'une grande quantité d'informations non expurgées”. Elle aurait également déclaré que la publication par M. Assange “en toute connaissance de cause et sans discernement au monde entier des noms de personnes ayant servi de sources d'information aux États-Unis” est la “base objective” qui le distingue des autres médias ayant expurgé ces informations mais rendu compte des divulgations sous-jacentes. Elle poursuit : “Le contenu que [Assange] a publié sans être expurgé ne présente aucun intérêt général”, ce qui constitue la “faille au centre de coeur de l'appelant”.
Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, le fait de ne pas avoir expurgé les noms des informateurs peut servir à caractériser l'affaire Assange d'un point de vue pratique et éthique, mais il n'est pas pertinent d'un point de vue juridique. La loi sur l'espionnage ne se fonde pas sur le préjudice relatif ou l'intérêt public de la divulgation des informations. Elle parle simplement de documents “tangibles” - livres de codes, photographies, plans, cartes, etc. - ou d'informations “relatives à la Défense”, que les tribunaux caractérisent comme informations “potentiellement préjudiciables” à la Sécurité nationale si elles sont divulguées alors que le gouvernement s'est efforcé de les garder secrètes. Autrement dit, la loi sur l'espionnage ne fixe pas le champ d'application suggéré par le gouvernement.
En outre, la position du gouvernement consiste essentiellement à dire que l'affaire Assange se distingue par la gravité relative à la divulgation des identités des informateurs. Mais les représentants du gouvernement trouveront toujours le moyen de qualifier de grave n'importe quelle fuite prétendument préoccupante pour la Sécurité nationale.
Par exemple, les Pentagon Papers sont aujourd'hui considérés comme la quintessence d'une divulgation d'intérêt public : révélation de malversations gouvernementales, absence de secrets exploitables par un adversaire, et pertinence directe dans le cadre d'un débat public passionné et permanent sur la nature même de notre démocratie. Mais, au moment où il a cherché à bloquer la publication, le gouvernement a déposé de manière controversée une annexe spéciale auprès de la Cour d'appel des États-Unis du second district, arguant, très explicitement, que la divulgation nuirait de manière manifeste et grave aux objectifs de guerre des États-Unis au Viêt Nam.
Comme nous l'avons écrit en 2019 lorsque la nouvelle de l'inculpation d'Assange a été rendue publique pour la première fois, des allégations contre lui - à savoir qu'il aurait été complice de Chelsea Manning pour avoir “craqué” un mot de passe d'un réseau gouvernemental classifié - font sortir “cette affaire de la catégorie “facile” pour les défenseurs de la liberté de la presse”. Mais ces arguments n'ont rien à voir avec la théorie des “sources”, et il est inquiétant de constater que le gouvernement continue à les invoquer devant le tribunal.
Le projet "Technologie et liberté de la presse" du Comité des reporters pour la liberté de la presse (Reporters Committee for Freedom of the Press) pratique un traitement intégré - combinant le droit, l'analyse politique et l'éducation du public - pour défendre et promouvoir les droits de la presse sur des questions au croisement de la technologie et de la liberté de la presse, telles que la protection de la confidentialité des sources des journalistes, le droit et la politique en matière de surveillance électronique et la réglementation du contenu en ligne et dans d'autres médias. Le TPFP est dirigé par Gabe Rottman, avocat du Reporters Committee. Il travaille avec Grayson Clary, avocat salarié du RCFP, et Emily Hockett, collaboratrice du projet Technologie et liberté de la presse.