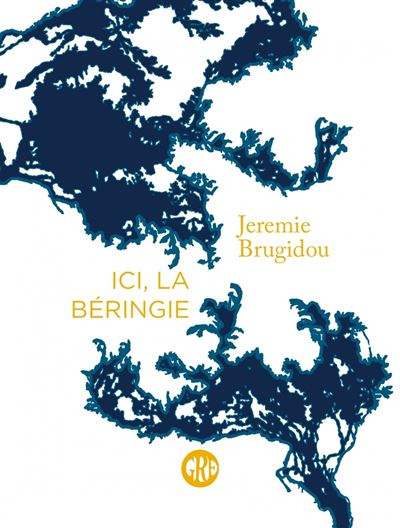👁🗨 Ici, la Béringie : « Les inventions de l’imaginaire s’opposent aux inventaires de la gestion ».
Certains rêves puissants mangent les rêves plus subtils tout comme l’éclairage de nos lumières blanches fait disparaître les lumières ténues produites par les organismes vivants, la bioluminescence.
👁🗨 Ici, la Béringie : « Les inventions de l’imaginaire s’opposent aux inventaires de la gestion ».
Par Jean-Philippe Cazier, le 19 août 2021
Certains rêves très puissants peuvent manger les rêves plus subtils, tout comme l’éclairagede nos lumières blanches peut faire disparaître les lumières plus ténues produites par les organismes vivants, la bioluminescence.
Ici, la Béringie, le premier roman de Jeremie Brugidou*, est un livre puissant et pluriel, porteur d’un imaginaire et de thèmes qui résonnent avec des questions fondamentales d’aujourd’hui : l’écologie, le rapport au monde, à l’animal, les catastrophes planétaires, l’invention d’imaginaires nécessaires à d’autres existences sur Terre, le capitalisme, le colonialisme… Entretien avec Jeremie Brugidou.
Ton roman se situe à trois époques et en partie dans un futur qui demeure indéterminé, après les années 2040. Cette position dans un futur évoque pourtant des thématiques et un imaginaire actuels : destruction de l’environnement, colonisation, appropriation du monde, effets catastrophiques du réchauffement, fin du monde ou d’un monde, etc. Le roman développe, à partir de ces thématiques, un point de vue critique sur le présent. Pourquoi développer ce point de vue critique à partir d’un futur imaginaire plutôt qu’en se situant dans un présent bien réel ? Autrement dit, du point de vue de la critique, et plus généralement de la construction du roman, que permet de particulier cette situation dans le futur, ce passage par l’imaginaire ?
J’ai du mal à opposer si clairement un futur imaginaire et un présent bien réel. Le réel du présent n’est peut-être pas si évident pour moi. C’est aussi ma pratique de cinéma documentaire qui fait ça. J’ai compris assez vite qu’on ne filme jamais vraiment le réel mais la rencontre de notre imaginaire avec la matière du monde et l’imaginaire des autres. Le réel se produit quelque part dans cette zone de rencontre et c’est très éphémère. Alors le futur proche c’est plutôt une manière de concrétiser cette irréalité inhérente au présent. Ça me permet d’extrapoler certaines tendances, d’être un peu joueur et critique à la fois, sans toutefois prétendre mieux comprendre le présent qu’un·e autre. C’est une petite marge que j’étire à partir du présent dans laquelle je peux me permettre des libertés. Je serais, je pense, beaucoup trop prudent si j’avais à parler immédiatement du présent.
Le futur proche, c’est une sorte de médiation, un petit détour qui permet de mieux appréhender ce qui dans l’invisible me travaille au présent, de faire de notre présent un passé et donc tout de suite de nous déplacer en tant que lecteur·trice. C’est le jeu temporel qui m’a inspiré dès le départ de ce projet avec la Béringie : une bande de terre qui a été identifiée bien après sa disparition à partir des traces florales de son futur dans notre présent. Que nous reste-t-il aujourd’hui des existences humaines qui ont peuplé cette zone, à part les traçages génétiques de part et d’autre du détroit ? Pouvons-nous encore imaginer un présent dans ce lointain passé aujourd’hui submergé à plusieurs centaines de mètres de fond ? J’aime bien que l’on soit légèrement en décalage avec le maintenant, ça permet d’ouvrir un peu l’attention et la sensibilité à ce qui vient par la suite. Disons que ça prépare le terrain. Ça dit que nous ne serons jamais vraiment « chez nous », il y aura toujours une marge d’indétermination, un glissement, qui me semble nécessaire, dans l’expérience de lecture, afin d’ouvrir l’accès aux autres dimensions que je tente de faire émerger, dans l’infrasensible d’un « présent bien réel » qui a lieu aussi bien dans le passé et le futur.
Le livre s’organise à un premier niveau autour d’une opposition, même si son organisation se révèle plus complexe que ce que j’en dis là. Cette grande opposition distingue deux façons de se rapporter au monde, autant intellectuellement et psychiquement que pratiquement. D’un côté, il y a un rapport au monde qui privilégie l’idée de lien et de continuum, de l’autre il y a un rapport au monde basé sur l’idée de séparation, de division et d’exploitation. Ce second point de vue serait celui de notre époque et en particulier de l’Occident, et dans ton livre, cette façon de se rapporter au monde est d’abord synonyme de destruction. Par exemple, la colonisation apparaît évidemment comme une destruction des relations sociales existantes, des individus, des milieux, mais aussi des façons de penser et des imaginaires. Quel est pour toi l’enjeu actuel d’aborder cette dimension de la colonisation comme destruction des imaginaires et plus généralement des façons de penser le monde et de s’y rapporter ?
Je me suis permis d’extrapoler certaines tendances, même si en fait je crois que je suis bien en deçà de certains désastres qui ont lieu aujourd’hui, dans le « réel » du présent. Évidemment, ça devient un peu convenu maintenant de critiquer le rapport « occidental » au monde, l’industrialisation, l’extractivisme, la notion de nature qui ne peut être que « sauvage » ou « ressource », et pourtant je crois qu’on n’a jamais fini de déconstruire toutes ces notions.
La colonisation est évidemment un des grands vecteurs de ce rapport au monde. Des chercheur.euses en anthropologie, en humanités environnementales, écosophie, écoféminisme, théorie des media etc., ont écrit des livres très importants ces dernières années sur ces sujets. La notion d’Anthropocène est entrée dans le débat public et c’est tant mieux, même si ce terme est très imparfait pour décrire les véritables rapports de force qui se jouent. La théorie critique sur le sujet est monumentale, incontournable selon moi aujourd’hui si on veut parvenir à transformer un tant soit peu le futur qui se déplie de proche en proche. En incluant ces éléments dans la fiction, j’essaie de me focaliser sur des points légèrement différents. J’ai essayé d’aborder les sphères qui me paraissent avoir le plus souffert de plusieurs siècles d’exploitation des écosystèmes, mais je m’attarde surtout sur la sphère des imaginaires qui a été aussi bien épuisée.
Quand je parle d’écosystèmes au pluriel, j’entends les écosystèmes physiques – ce qu’on entend habituellement par environnement – mais aussi sociaux et mentaux. C’est l’ensemble de ces trois écosystèmes qui a été profondément blessé par certains rapports au monde particulièrement agressifs et voraces. Les génocides comme ceux qui se sont perpétrés au sein de nombreuses communautés autochtones lors de leur « découverte » par les européens sont des tragédies humaines, mais aussi mentales, spirituelles, énergétiques, quand la majorité d’une communauté nourrissant un rapport infiniment riche au monde et tellement différente de la nôtre aujourd’hui est exterminée ou réduite au silence, ridiculisée, diabolisée, précarisée, etc. Évidemment toute une partie de ces communautés ont continué, se sont transformées et ont très bien composé avec leur monde et le nouveau, mais les blessures sont énormes.
Il me semble qu’une chose que nous pouvons faire en tant qu’auteur.rices est de mesurer l’envergure des réparations qui demandent de l’attention, et surtout de construire des relations libérées des idéologies coloniales ou plus généralement oppressives et exploitantes, que l’on trouve encore dans la logique du capitalisme global qui affecte l’ensemble des trois niveaux écosystémiques dont j’ai parlé. Un des enjeux actuels – parmi plein d’autres tout aussi urgents appartenant aux écosystèmes physiques et sociaux – se situe donc au niveau des imaginaires ou écosystèmes mentaux. On a peut-être même une idée assez restreinte actuellement de ce que veut dire écologie : bien sûr cela recoupe un certain nombre de comportements, d’initiatives, de réglementations, mais avec lesquels finalement le capitalisme hérité du colonialisme compose assez bien pour se perpétuer. Ne pourrait-on pas imaginer une idée plus radicale de l’écologie qui impliquerait une véritable imbrication dans les tissus vivants du monde, une préoccupation constante qui ne concernerait pas que les niveaux de CO2, les températures, les pourcentages d’extinction, mais aussi des désirs, des craintes, des préférences, des inventions, proposés par les autres qu’humains autour de nous ? Cette interdépendance créative se développe d’abord dans les imaginaires selon moi.
Dans Ici, la Béringie, la façon de penser et de pratiquer le monde à partir de l’idée de séparation – celle qui implique l’absence de relations, d’interrelations ou de continuité entre les dimensions du monde – caractérise un certain nombre de personnages et de pratiques : archéologues, scientifiques, entrepreneurs… Il y a par exemple ce passage où des braconniers tuent des rhinocéros pour utiliser des parties de leurs corps dans un but utilitaire : ils sectionnent leurs pattes pour en faire des objets, des poubelles, des porte-parapluies. Ou, autre exemple, un projet qui rappelle celui de Jurassic Park. Il y a aussi les scientifiques ou les archéologues qui veulent organiser, classifier, comprendre en réduisant à des catégories rationnelles occidentales, comme par exemple la notion d’espèce. Il s’agit dans tous les cas d’une forme d’appropriation du monde et du vivant que tu relies au capitalisme, à l’idée de simple gestion, à l’idée du monde comme ensemble de ressources exploitables. Cette façon de concevoir le monde et de l’exploiter s’oppose à d’autres manières de se rapporter au monde, ce que l’on voit à travers le personnage de Sélhézé ou encore par ces groupes qui jouent du tambour de manière étrange. En quoi, selon toi, l’idée de monde en tant que simplement exploitable est-elle une caractéristique occidentale ? Quels sont les enjeux actuels de la mise en évidence de cette représentation du monde ?
Je pense que mon roman navigue entre des lignes très épaisses et des lignes très fines. Certaines de ces lignes épaisses sont des grandes tendances que l’on identifie assez facilement aujourd’hui en sciences sociales et que l’on associe par simplicité à l’Occident. Ce n’est pas faux, mais c’est évidemment un gros trait. L’exemple du braconnage est intéressant à ce propos. Les responsabilités sont très diffuses, les motifs variés, le positionnement très incertain. C’est l’Occident et pas l’Occident, c’est nous et les autres, pris·es dans un même système de safari et chasse et tourisme et braconnage et propriété privée et médecine « traditionnelle » et réseaux de trafics-conservation, etc.
Le Parc que j’extrapole dans le roman – car il existe bel et bien aujourd’hui sous une forme plus modeste pour le moment – est l’occasion de questionner un impératif peu remis en question, celui de la conservation : pourquoi conserver ? sur quoi repose-t-elle, qui sert-elle, à qui profite-t-elle, à quel prix se fait-elle ? Le terme même de conservation est très étrange appliqué au vivant, mais s’il doit y avoir des initiatives de conservation, je pense qu’elles ne peuvent pas se faire sans l’implication des communautés locales, ce qui veut dire écouter aussi leurs propres manières d’envisager cette conservation qui peuvent être très différentes des nôtres. Il s’agit d’enjeux territoriaux et dans le roman ces frictions territoriales sont rendues très sensibles avec le personnage de Sélhézé notamment. Elles se jouent entre humains, mais aussi entre humains et non-humains et entre non-humains.
L’héritage philosophique européen associé à une série de dispositifs techniques et des logiques économiques et de contrôle ont contribué à fabriquer notre modernité avec sa rupture fondatrice « homme » / « nature ». Il me semble que si l’on veut vraiment entamer un nouveau type de rapport avec l’environnement que celui de la destruction – car il n’est pas nécessaire, mais conjoncturel : l’humain n’a pas toujours été néfaste et ne l’est pas toujours, au contraire, nous avons participé à l’évolution et la biodiversification du vivant –, il faut non seulement modifier les pratiques, mais aussi les manières de concevoir ce qu’est « le monde ». Ce n’est pas juste nos représentations ; ça se joue à un niveau beaucoup plus fondamental, un niveau sur lequel reposent nos représentations. Ça se joue au niveau de ce qu’on imagine être l’humain, l’humanité, le monde, notre monde et celui des autres.
Jusqu’à présent, cet imaginaire en Occident nous a mené à une dégradation des relations avec l’autre qu’humain. L’enjeu c’est d’ouvrir quelques brèches pour permettre à nouveau à la sensibilité, la curiosité, les rêves, de se brancher sur autre chose que nous-mêmes et peut-être tordre les avenirs délétères qui s’annoncent. Je voudrais imaginer un avenir où ce ne serait pas l’idéal de contrôle et de maîtrise des environnements par la technique qui serait central – par exemple avec le geo-engineering – mais l’idéal d’une meilleure inscription dans les environnements, avec un souci de co-habitation multi-espèce. Cette inscription passe notamment par la qualité des histoires qu’on a envie de se raconter relatives aux lieux qu’on habite et aux autres formes vivantes qui les peuplent avec nous. C’est donc bien une politique des imaginaires.
Lorsque je dis que dans le roman la science est définie par un rapport réducteur au monde qui présuppose une logique de la séparation, ce n’est pas entièrement vrai puisque l’on trouve aussi, évoquées, certaines notions qui sont présentées comme appartenant au champ de la science au sens large et qui permettent de penser le monde selon des schémas et imaginaires différents. Dans le roman, il est question par exemple de la notion de « biomythologie » ou encore de « transpèce », notions qui existent effectivement mais que tu reprends dans un sens différent. Dans ton roman, que signifient ces notions et quels enjeux leur sont liés ? Plus généralement, puisque tu es aussi, en plus d’être cinéaste, chercheur en anthropologie et éthologie, que t’apporte la science dans la construction d’une œuvre littéraire comme Ici, la Béringie ? De manière plus générale encore, comment conçois-tu, pour ton propre compte, la possibilité de rapports entre la science et la littérature, entre la science et l’imaginaire ?
La biomythologie et le transpèce sont des opérateurs d’hybridation de la pensée. Ce sont des concepts qui permettent des branchements, notamment entre ce qu’on considère comme « scientifique » et comme « mythologique ». La biomythologie entend penser une phylogénie des imaginaires, c’est-à-dire une histoire évolutive des subjectivités et non seulement des organismes. Dans certains mythes, il se raconte des filiations entre humains et non-humains : je considère que ces filiations ou ces échanges sont bien réels, mais se situent sur un autre plan que l’organique, plutôt dans l’affectif, l’intime, la sensibilité.
Par exemple, nous avons sans doute hérité de modes d’attention provenant d’autres espèces vivantes. Aussi, dans certains mythes, la création du monde est menée par des animaux : il me semble qu’il y a dans ces histoires des intuitions très profondes du rôle joué par les autres qu’humains dans la forme qu’a pris la vie sur terre. Nous ne sommes pas les seul·e·s à transformer le monde, ni les seul·e·s à s’y intéresser. Dans cette idée, le transpèce désigne un mode relationnel dans lequel la catégorie d’espèce n’a pas de pertinence. Les intériorités peuvent circuler au-delà des distinctions que l’on considère habituellement comme nécessaires et indiscutables, établies par la catégorisation d’espèce.
J’ai beaucoup travaillé dans les domaines de l’anthropologie, mais je ne suis pas chercheur en anthropologie. J’ai un doctorat en esthétique, en théorie de l’art, ce qui me permet une certaine marge de manœuvre conceptuelle avec des alliages entre les domaines de l’art, de la biologie, de l’anthropologie. La littérature est une étape supplémentaire dans cette liberté conceptuelle. La science est un matériau parmi d’autre avec lequel je me permets de jouer. Elle est selon moi un discours majoritaire de l’Occident, une narration principale qui fait autorité, et avec laquelle on ne peut pas ne pas composer pour penser notre situation actuelle. Les pratiques scientifiques apportent des choses merveilleuses mais aussi des réductions et cristallisent des paradigmes temporaires en réels indiscutables. J’en fais des mythologies au même titre que les mythologies nous provenant d’autres collectifs avec des rapports différents au monde, ce qu’on appelle plus communément aujourd’hui, en sciences sociales, des ontologies.
L’imagination a toujours eu un rôle central dans les pratiques scientifiques. Mais l’imaginaire ce pourrait être la puissance heuristique de l’imagination, sa capacité à nous rapprocher du monde, de sa compréhension, de ses émotions. Si l’imagination scientifique permet de comprendre certaines chaînes de causalité, l’imaginaire nous permet d’interagir et de communiquer avec les lieux que nous habitons, avec ce qui nous déborde et nous constitue en même temps. L’imaginaire n’empêche pas d’être méthodique. Par exemple, certains collectifs animistes ont un rapport au monde que des anthropologues ont qualifié de perspectiviste : de notre point de vue occidental, il s’agit d’une forme de méthode très complexe d’interaction avec le milieu régissant la chasse, la cueillette, les rêves, les connaissances du lieu, les relations aux esprits et aux autres habitants de la forêt. Le perspectivisme exige des imaginaires très forts afin de se mettre à la place des autres et d’imaginer les autres qui se mettent à notre place. La position d’humain-sujet n’est pas un donné immuable, il se négocie constamment. Le perspectivisme est une méthode régissant la circulation de la position subjective au sein d’une écologie de sujets. Pour moi, la science décrit très bien l’envers du décor, son extériorité, mais qu’est-ce qui peut permettre d’en décrire l’endroit, ses intériorités multiples et puissantes ? Peut-être l’imaginaire et notamment la littérature.
Dans le livre, le rapport à l’animal est omniprésent et s’organise selon l’opposition dont je parlais au début. D’un côté, l’animal est simplement manipulé, utilisé comme un objet, une ressource. D’un autre côté, ton roman développe un autre rapport à l’animal, ce dernier, dont il faudrait sans doute parler au pluriel, étant porteur d’autres rapports au monde, d’autres modes d’existence, d’autres langages, d’autres formes de communication, d’autres connaissances, etc. Qu’est-ce qui caractérise cet autre rapport à l’animal ? Qu’est-ce qui te paraît important dans le fait de redéfinir aujourd’hui l’animal, les animaux, et notre rapport à ceux-ci ?
Je pars d’une intuition simple qui est que l’humain est tout à fait capable de communiquer avec le non humain, que cela a longtemps été une évidence même en Occident et l’est toujours chez d’autres collectifs. Les animaux font partie de ce que nous avons construit dans l’ontologie naturaliste occidentale comme une altérité, au même titre que les plantes, les virus, les microbes, mais aussi les fantômes, les esprits. Aujourd’hui, nous partons du principe dans les sociétés industrialisées que l’humain est isolé, que nous sommes chacun·e des entités autonomes, et que nous devons fournir un effort presque « surnaturel » pour créer des connexions, des relations, avec l’autre. Dans d’autres collectifs, l’évidence est inverse : tout est relation et l’effort consiste à maintenir une individualité, une subjectivité, au sein d’une écologie de sujets très fortement imbriqués.
Beaucoup de personnes en sciences humaines rappellent, depuis une dizaine d’années notamment, cette diversité des rapports au monde et la nécessité de remettre en question la notion de « nature », d’« animal » etc. L’humain a longtemps été défini en opposition à l’animal, devenu sorte de pôle négatif de l’existence. Pourtant, notre si précieuse « humanité » provient d’une interaction constante avec les animaux et les autres présences terrestres depuis des millénaires. Nous avons tout appris d’elles et eux, notre fameux cerveau exceptionnel avec toutes ses caractéristiques uniques provient entièrement de notre observation, cohabitation, apprentissage mimétique des autres qu’humains. Les animaux sont une inspiration constante, leur diversité, leur inventivité, leurs mondes tellement différents du nôtre, en font une source inépuisable d’imaginaire et d’intelligence. Nous leur devons tout et avons selon moi une dette immense à leur égard. C’est cette réciprocité qui m’importe, la responsabilité que nous avons et la réponse-abilité que nous devons cultiver.
Il est actuellement souvent question de trouver des solutions : solutions à des impasses écologiques, solutions majoritairement enchaînées à des nouvelles technologies. Pourtant, c’est bien davantage des réponses que nous devons trouver : des réponses, car le monde autour de nous ne cesse de nous interroger, de nous enjoindre à participer à un projet commun qui est celui de la vie sur Terre. Une réponse, c’est un début d’échange et de communication, d’écoute et d’attention, pouvant mener à une éventuelle remise en question. Une solution, c’est souvent quelque chose qui tombe et s’impose. Redéfinir l’animal, c’est d’abord l’inclure au sein de la sphère des interlocuteurs·trices potentiel·le·s au sein de ce vaste enjeu de questions/réponses. Ce dialogue n’est pas toujours amical, ni ne doit l’être, mais il n’en reste pas moins un échange dynamique et transformatif, nous permettant de continuer à co-évoluer.
Ton livre est traversé par diverses représentations de l’écriture, du texte, du livre : écrire dans des carnets ; constituer un herbier ; chercher dans le sol, dans les vestiges, dans la nature, des traces ou signes qui permettent de les lire ; des récits sous la forme d’images pariétales ; etc. On trouve aux pages 14 et 15 une représentation du livre que je trouve très belle sous la forme d’un carnet qui réunit plusieurs graphies, et donc plusieurs auteurs, diverses couches temporelles, des pages lisibles, visibles, et d’autres collées, invisibles et illisibles, des plantes également collées et dont la tige troue le papier. Ce paradigme de ce que pourrait être un livre m’enthousiasme… Il y a dans ton roman, ces diverses représentations du livre et de l’écriture, représentations qui impliquent des formes diverses d’écriture et des finalités diverses de l’écriture. Dans ton livre, on peut remarquer une différence par rapport aux autres chapitres dans la façon dont tu écris lorsqu’il s’agit du personnage de Sélhézé, ton écriture devient plus lyrique plus poétique. Tout ça pour dire qu’évidemment la question de ce qu’est ou pourrait être l’écriture, de ce qu’est ou pourrait être un livre se pose à toi. Quelle est, sinon la définition, du moins l’idée de l’écriture et de sa finalité qui accompagnent ta pratique d’écrivain ?
Merci pour cette lecture et cette idée que tu soulèves. Effectivement le livre, la littérature, est pour moi un lieu d’accueil, en tout cas j’essaie de l’aménager dans ce sens. Un espace où peuvent loger temporairement des voix, des chants, des mondes, des sensibilités, des subjectivités très différentes, et entrer en correspondance. Le texte est constamment troué d’incursions étranges, il est aussi construit sur une forme d’imbrication de subjectivités très différentes qui ont des modes narratifs différents. Schématiquement, on pourrait dire que Hushkins à la troisième personne est à l’antipode de Sélhézé à la deuxième personne, et Jeanne se trouve un peu entre les deux, à la première personne, à devoir faire le pont, c’est-à-dire à reconstruire une nouvelle position subjective. C’est ce projet de construire une subjectivité qui m’importe dans l’écriture. J’aime à penser que la position principale de sujet, que nous considérons comme élémentaire, évidente, immédiate, est une position sans cesse à construire sans quoi elle sera déterminée par d’autres.
Certains rêves très puissants peuvent manger les rêves plus subtils, tout comme l’éclairage très puissant de nos lumières blanches peut faire disparaître les lumières plus ténues produites par les organismes vivants, la bioluminescence. Pour moi, la littérature est un espace sombre préservé et qui rend possible l’émergence éphémère et volatile de luminosités mineures. Sélhézé porte en elle, en tant que collecteuse de sensations, beaucoup de ces lueurs, et elle en est une elle-même dans l’écologie du texte. C’est une voix à la fois très intime et très lointaine, avec la deuxième personne du singulier. C’est aussi une voix qui n’est présente que dans l’adresse, c’est-à-dire dans la relation, dans la dividualité, elle est d’abord relation avant d’être individu. L’écriture, c’est un endroit, je crois, où je peux entretenir le dialogue avec le monde.
Au début de cet entretien, je disais que ton livre s’organise autour d’une grande opposition. Je peux maintenant revenir sur cette affirmation qui n’est pas suffisante puisque ce que tu fais dans ce roman consiste aussi, en-deçà ou par-delà cette opposition, et comme tu viens de l’évoquer, à créer des liens, des relations entre ce qui au premier abord paraît et est effectivement opposé : l’opposition molaire est trouée de relations moléculaires. Les trois personnages principaux du roman vivent à des époques différentes, dans des mondes différents, dans des rapports au monde différents. Pourtant des échos, qui peuvent se révéler dans des détails, existent entre eux, des relations énigmatiques. De même les mondes qui correspondent à ces trois périodes sont distincts et pourtant il y a des similitudes, des formes de rencontres. On découvre des rencontres et interrelations entre les règnes, entre des événements éloignés. Il est aussi question de la séparation du continent européen et américain mais aussi, par l’intermédiaire de la Béringie, par l’intermédiaire des plantes, de leurs rapports possibles. Et toute la fin du livre s’articule autour de la coprésence de ces divers mondes, de leur articulation sous une forme là encore énigmatique, qui relève davantage encore de la science-fiction ou du fantastique, puisque tu transgresses aussi volontiers les limites des genres littéraires. Quelle est pour toi aujourd’hui, de manière générale, l’importance de cette idée de relations, d’interrelations ? Quelle place pourrait selon toi jouer la littérature dans cette pensée des relations ?
Tu évoques le moléculaire, et bien sûr je suis dans cet intérêt pour les devenirs autres, c’est-à-dire les proximités moléculaires, subtiles, dans les détails et les affects infrasensibles – et la littérature est un espace privilégié pour donner à sentir et à imaginer ces devenirs. Le cinéma l’est aussi puisque l’acte cinématographique est directement dans la relation et ses transformations : filmer, c’est autant enregistrer que projeter, c’est créer un champ hybride de matière réelle et imaginaire.
Je me sers beaucoup de mon expérience cinématographique dans l’écriture, elle me fournit un matériau sensible et relationnel très efficace que la littérature permet de creuser encore différemment. L’écriture a l’avantage de pouvoir en même temps introduire une distance et une réflexivité sur cette sensorialité, tout en restant dans la narration. Dans mon écriture, je me sers de mon imaginaire cinématographique et des pratiques qu’il engage, comme le montage, pour créer des impacts sensoriels, et j’y ajoute une plasticité narrative.
Pour moi, la question de la narration est centrale à la pensée des relations. La manière de raconter peut inclure ou exclure tout un ensemble de petits récits. Il faut construire l’attention qui permettra de les écouter et d’y être sensible. Selon moi, cet effort narratif passe en partie par la variabilité des positions d’énonciation et des présences vivantes qu’on rend sensibles et agissantes. Le travail de l’écriture est alors un travail de désindividualisation, pour moi comme pour les personnages, et de recomposition d’individus redéfinis dans leur relation avec l’autre.
Il me semble crucial aujourd’hui de rendre très concret la primauté de la relation. L’écriture, c’est une matérialisation des relations, c’est une des formes plastiques de cet imaginaire. Nous sommes chacun et chacune un ensemble hétéroclite d’existences enchâssées, matérielles et immatérielles, depuis les bactéries intestinales jusqu’aux esprits. Considérer la relation comme première, c’est se rendre compte qu’en polluant un fleuve on se pollue soi-même ; la forêt qui brûle se consume aussi en nous ; chaque espèce qui disparaît est une portion du sensible qui disparaît, donc un peu moins d’intelligence et de joie en nous.
Ton livre se situe en Sibérie orientale, vers la mer de Béring, et il y est question, justement de cette zone à la fois imaginaire et qui paraît avoir réellement existé, appelée Béringie. Cette zone est, dans le roman, le lieu de la séparation et du lien : lien entre deux zones géographiques, séparation d’avec aujourd’hui mais aussi lien possible avec aujourd’hui, entre le passé et le présent, etc. Est-ce un imaginaire particulier, attaché à cette zone, qui t’a fait choisir celle-ci ?
La Béringie est une portion de terre qui a bien existé et qui a été peuplée par des hominidés pendant des dizaines de milliers d’années. C’est quand je me suis rendu compte que le «passage de Béring», qui a permis aux populations eurasiennes de peupler l’Amérique, n’avait pas été qu’un passage mais un véritable monde, que l’imaginaire de cette zone s’est ouvert à moi. J’ai soudain été frappé d’une dissociation temporelle : ce que nous considérions comme un passage avait été un monde pour d’autres, et donc ce que nous considérons comme le monde ne deviendra qu’un passage pour d’autres ? En plus, la Béringie a été submergée et aujourd’hui on parle de plus en plus de la montée des eaux qui aura sans aucun doute des conséquences désastreuses, en particulier dans certaines zones qui subissent de plein fouet l’hubris de notre mode de vie industriel. Il y avait donc pour moi un écho certain et un effet de chiasme qui m’a inspiré.
Le détroit de Béring porte le nom d’un commandant qui cherchait à relier l’Amérique depuis la Russie en bateau et cherchait constamment des signes de proximité de la terre ferme. En miroir, j’ai imaginé une subjectivité qui, par une condensation fictive de temporalité, pouvait repérer des signes de pleine mer au milieu des terres. Par ailleurs, le détroit de Béring sépare deux grands États, mais de part et d’autre se trouvent des communautés autochtones qui se ressemblent et ont subi les mêmes types d’oppressions. Il y avait donc un jeu constant de séparation et de jonction, que j’ai notamment matérialisé à travers l’idée du pont, réel et imaginaire. Un pont se construit entre les deux grandes puissances, le pont du pouvoir technologique, et en parallèle le personnage de Jeanne construit un autre pont, immatériel, entre des temporalités et des rapports au monde, qui permet de faire converger des formes de résistances et de créativités.
Concrètement, ce qui est refusé c’est le rapport au monde qui a conduit à la confiscation des terres des autochtones, à la destruction de leurs modes de vie et de leurs ontologies, le rapport au monde qui instrumentalise le vivant comme une monnaie vivante, qui exploite et spolie les t erres en même temps, ce rapport au monde qui ne pense qu’à l’appétit de l’humain et même qu’à une petite portion de l’humanité. L’inventivité dans les relations s’oppose au profit engrangé dans les destructions. Les inventions de l’imaginaire s’opposent aux inventaires de la gestion. L’imaginaire peut porter des formes de résistances et de révolutions puissantes. L’imaginaire traverse les temporalités dans le roman et aboutit finalement à une première action lorsque les conditions y deviennent propices. C’est l’amour qui constamment donne l’énergie à cet imaginaire pour continuer à travers les temps.
* Jeremie Brugidou, Ici, la Béringie, éditions de l’Ogre, août 2021, 208 p.