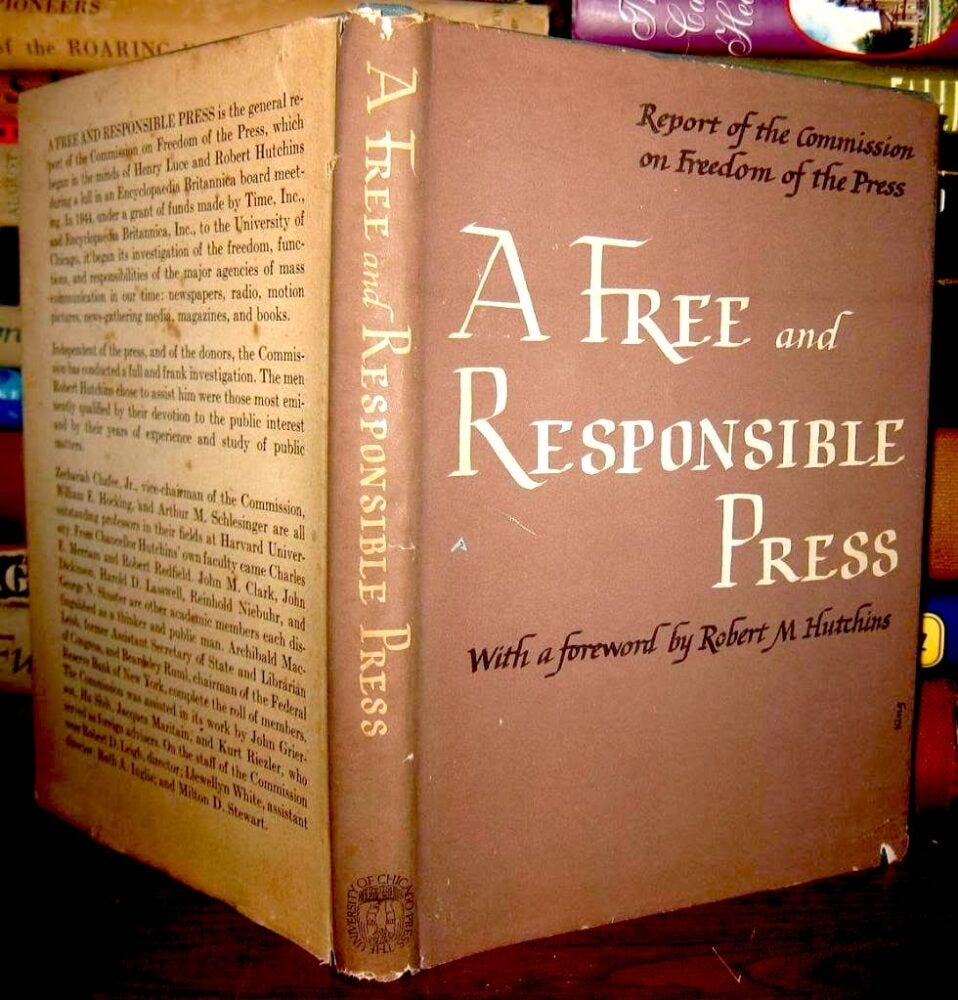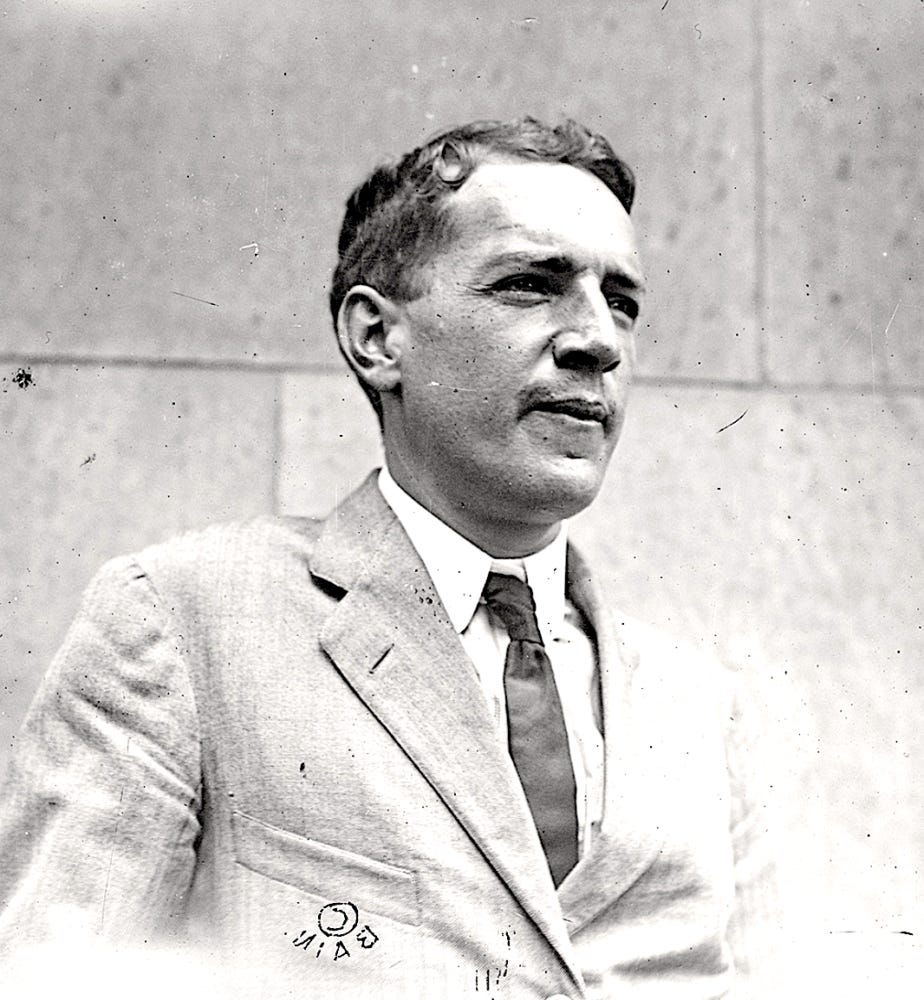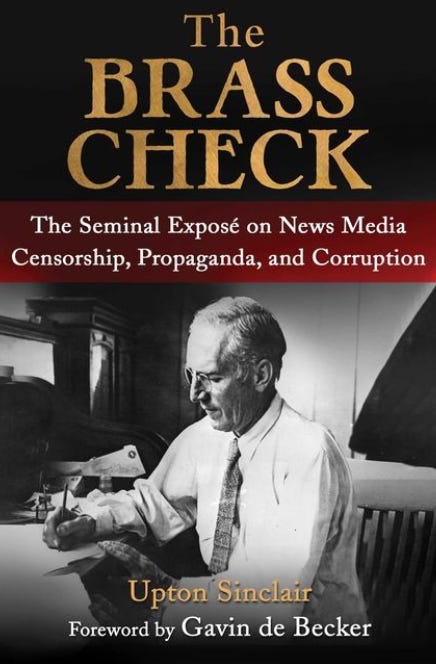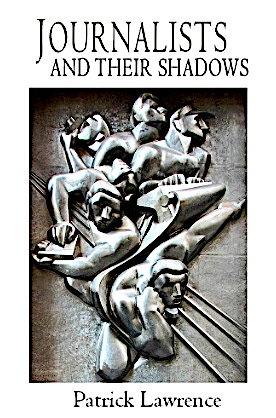👁🗨 Patrick Lawrence : Mauvaise foi & chèques en blanc.
Il n'y a aucune raison d'attendre des médias dominants qu'ils recouvrent une indépendance mise de côté au profit de l'État de sécurité nationale - en tout cas, pas dans les conditions actuelles.

👁🗨 Mauvaise foi & chèques en blanc.
Par Patrick Lawrence*, Spécial Consortium News, le 4 septembre 2023
“Journalists and Their Shadows” (Les journalistes et leurs ombres) vient de paraître chez Clarity Press. Un extrait précédemment publié du nouveau livre de l'auteur peut être lu ici.
Il y a quelques années, alors que le déclin des médias américains devenait flagrant, même pour ceux ne faisant pas partie de la profession, des amis et des connaissances ont commencé à se poser deux questions. Les journalistes croient-ils ce qu'ils rapportent et écrivent ? Ou bien savent-ils que ce qu'ils nous disent est trompeur ou faux, mais induisent en erreur ou mentent pour conserver leur emploi ?
Je n'avais pas de réponse toute faite à ces questions, mais je les ai accueillies comme autant d'indices d'une saine perte de foi, d'une autre “désillusion”. Elles supposaient un public de lecteurs et de téléspectateurs plus conscient, plus attentif à la crise de nos médias, comme l'était le public lorsque Henry Luce a financé la Commission Hutchins. (La Commission a publié A Free and Responsible Press en 1947).
Pour tenter de répondre à ces questions, je dirai que le journalisme d'aujourd'hui est un cas remarquablement répandu de la mauvaise foi de Jean-Paul Sartre. La mauvaise foi, en des termes, espérons-le, pas trop réducteurs, revient à se faire passer pour quelqu'un ou quelque chose d'autre que soi-même. C'est renoncer à l'authenticité, cette valeur essentielle de la pensée de Sartre. La mauvaise foi consiste à jouer un rôle pour répondre aux attentes des autres tels qu'on se les représente. L'exemple célèbre de Sartre est celui du garçon de café dont chaque mouvement - “un peu trop précis, un peu trop rapide” - est une représentation artificielle de ce qu'il croit que les clients attendent d'un serveur de café. En termes philosophiques, il s'agit du “pour-autrui” par opposition au “pour-soi”.
Un ancien journaliste l'a expliqué très simplement dans le fil de commentaires en annexe de l'un de mes articles. “J'étais comme la plupart des journalistes que j'ai connus au cours des décennies passées dans le métier. J'étais un imposteur”.
Voilà le journaliste américain tel qu'il est devenu, un journaliste pour-autrui. Moins il est authentiquement journaliste - journaliste pour lui-même - plus il doit s'en tenir à l'image convenue du journaliste. Il est “l'homme sans ombre”, comme l'a dit Carl Jung dans un autre contexte. Devenu une nouvelle “personne désindividualisée” de la société - toujours selon Jung - le journaliste joue désormais un rôle, en termes psychothérapeutiques. Les journaux, de la même manière, sont au fond des réactualisations de journaux.
Aux amis qui me le demandent, je dis maintenant que les journalistes ne sont pas des menteurs, pas précisément. “On ne ment pas sur ce que l'on ignore,”, écrivait Sartre dans L'Être et le Néant, “on ne ment pas lorsqu'on répand une erreur dont on est soi-même dupe”. C'est le terme parfait pour désigner le journaliste déboussolé de notre époque. On en revient au retournement de Descartes. “Je pense, donc je suis” devient “Je suis, donc je pense”. Voilà ce que je veux dire : je suis journaliste au Washington Post, et par conséquent, voici ce que je pense et ce que je comprends du monde dont je parle.
L'auto-illusion telle que je la décris est l'une des deux forces sous-jacentes à la mauvaise pratique du journalisme dans les salles de rédaction. On ne saurait trop insister sur son pouvoir. Respirez de l'air vicié suffisamment longtemps et vous perdrez toute notion des brises printanières. Je n'ai jamais rencontré de journaliste de mauvaise foi capable de reconnaître ce qu'il s'est lui-même infligé au cours de sa vie professionnelle - son aliénation, et les artifices dont lui et son travail sont faits. L'illusion de soi est une globalité pour la conscience.
Le "chèque en laiton".
La deuxième force est intimement liée à la première et, de par son aspect pratique, est encore plus convaincante. Je fais ici référence à ce qu'Upton Sinclair appelait, il y a un siècle, “le chèque en laiton”. Nous devons maintenant nous pencher sur la question de l'argent. Peut-on imaginer une seule auto-illusion qui ne serait pas obtenue par le biais de l'argent ?
Sinclair considérait The Brass Check comme l'un des deux livres les plus importants qu'il ait jamais écrits, l'autre étant The Jungle. Il l'a auto-publié en 1919 et l'a laissé sans droits d'auteur dans l'idée qu'il devait être librement accessible. Il s'agit d'un farouche réquisitoire de 445 pages contre la presse américaine dans toute sa défiguration. Il n'est pas bien écrit : la prose est dépourvue de grâce, souvent criarde et riche en références désuètes. Mais il est vertueusement implacable. Il nous offre une base historique qui nous permet de comprendre que la crise que traverse aujourd'hui le journalisme américain est une histoire de longue date. Malgré toutes ses singularités, ce livre est particulièrement pertinent pour notre époque. Robert McChesney, le célèbre critique des médias, a publié une nouvelle édition aux Presses de l'Université de l'Illinois en 2003.
Sinclair était un homme curieux. Il a été élevé dans un milieu aisé à New York et s'est installé à Pasadena, mais son mépris pour le capitalisme américain s'apparente à celui d'un populiste de la Prairie. The Brass Check est une condamnation de la capacité du capital à corrompre la presse, et Sinclair la tenait pour totalement corrompue.
“Non pas de manière hyperbolique et méprisante, mais littéralement et avec une précision scientifique”, écrit-il avec mépris, “nous définissons le journalisme en Amérique comme l'activité et la pratique consistant à présenter les nouvelles du jour dans l'intérêt des privilèges financiers”.
C'est l'histoire du “chèque en laiton” qui m'a ramené au livre de Sinclair. Il l'a entendue alors qu'il était étudiant à New York au début du 20e siècle. Les “chèques en laiton” semblent avoir fait partie du paysage de la prostitution à l'époque. Un client se présentait à la maison de passe de son choix et payait la maquerelle pour une soirée de plaisir. En retour, il recevait un jeton de laiton et, lorsque la femme de son choix l'emmenait à l'étage, il lui remettait le jeton. À la fin de la soirée, la prostituée rendait les jetons à la maquerelle. Le client rentrait chez lui satisfait (vraisemblablement), la femme de la nuit était payée correctement (vraisemblablement) et le propriétaire gardait le contrôle de l'argent.
Cette histoire a marqué durablement le jeune Sinclair. “Plus d'un parasite se nourrit de la faiblesse humaine, et ce type de prostitution peut être symbolisé par le chèque en laiton”, se souvient-il dans le livre qu'il publia deux décennies plus tard.
“Le chèque en laiton se trouve dans votre enveloppe de paie chaque semaine - vous qui écrivez, imprimez et distribuez nos journaux et nos magazines. Le chèque en laiton est le prix de votre honte - vous qui prenez la juste part de vérité et la bradez sur la place du marché, qui trahissez les espoirs virginaux de l'humanité dans le bordel détestable des grandes entreprises”.
Voilà Sinclair - bouillonnant, basculant souvent dans la prose congestionnée de l'indignation. Mais il justifie cette indignation de façon convaincante, bien qu'histrionique. Il confirme un jugement dont j'ai déjà parlé. L'enjeu de la mauvaise conduite des journalistes américains est bien plus important aujourd'hui qu'à l'époque de Sinclair. Entre-temps, l'Amérique s'est imposée comme une puissance mondiale. Il est d'autant plus remarquable de réfléchir à la mesure dans laquelle la guerre de l'information qui pèse de manière décisive sur tant d'événements mondiaux majeurs est entretenue par des rédacteurs et des correspondants dont les principales préoccupations sont leurs aspirations matérielles quotidiennes - maisons, voitures, soirées, vacances. C'est ce que j'ai constaté à maintes reprises au cours des années passées dans la presse grand public. Ce problème de proportions est difficile à concilier a, étant donné qu'il l'était davantage à l'époque de Sinclair, mais c'est toujours le problème tel qu'il l'a identifié.
Sinclair sombre dans la folie lorsqu'il termine The Brass Check.
“Maintenant, ce mystère n'en est plus un”, s'exclame-t-il. “Nous savons maintenant ce que le devin de Patmos avait prévu : le journalisme capitaliste ! Et lorsque je vous invite, vous les travailleurs conscients de votre classe, à organiser et à détruire cette mère de toutes les iniquités, nul besoin de m'écarter du langage des anciennes écritures.”
Et de citer Ezéchiel.
The Brass Check se termine justement par une telle ouverture, heureusement. Dans un chapitre intitulé “Un programme concret”, Sinclair propose une voie à suivre pour sortir de la mère des iniquités qu'il a fini de décortiquer.
“Je propose que nous fondions et financions une publication hebdomadaire de vérité qui portera le nom de ‘The National News’” écrit-il. Voici Sinclair décrivant le type de journal dont il pensait que l'Amérique avait besoin :
"Il ne s'agira pas d'un journal d'opinion, mais d'un compte rendu pur et simple des événements. Il sera publié sur du papier journal ordinaire et sous la forme la moins chère possible. Il n'aura qu'un seul but, celui de donner au peuple américain, une fois par semaine, la vérité sur les événements du monde. Il sera strictement et absolument non partisan, et ne sera jamais l'organe de propagande d'une cause quelconque. Il observera le pays et verra où les mensonges circulent et où la vérité est étouffée ; son travail consistera à démasquer les mensonges et à faire éclater la vérité au grand jour".
Il s'agit ni plus ni moins d'une invocation de l'idéal d'objectivité évoqué plus haut - jamais atteint, toujours à poursuivre. “The National News” ne diffuserait pas de publicité, se protégeant ainsi contre les pressions des intérêts corporatistes. Cela nécessiterait une subvention afin de maintenir le prix bas - une subvention “suffisamment importante pour assurer le succès”. Sinclair définit le succès exactement comme il définit le reste : “Je crois qu'un nombre suffisant d'Américains sont conscients de la malhonnêteté de notre presse pour permettre à un tel journal d'atteindre un tirage d'un million d'exemplaires par an”.
Le journal “The National News” n'a jamais vu le jour. Mais nous devons en conclure que le projet de Sinclair était mort-né. Je me doute bien que Cedric Belfrage et Jim Aronson ont lu The Brass Check, étant donné les excellentes ventes du livre et sa solide réputation. Mais peu importe. Lorsqu'ils ont fondé le National Guardian en 1948, ils se sont inspirés directement du livre de Sinclair. Le projet était un journalisme non contaminé par le pouvoir ou l'argent et soutenu par des lecteurs qui appréciaient la démarche.
[Lire aussi : Patrick Lawrence, Le journalisme indépendant à l’ancienne]
J'aurais aimé lire The Brass Check avant d'aller travailler dans ce loft mémoriel de West Seventeenth Street. C'est au Guardian que j'ai découvert pour la première fois la relation inversée qui existe si souvent entre le pouvoir et l'argent, d'une part, et le journalisme sans compromis ni langue de bois, d'autre part. Lorsque je me demande comment les journalistes américains peuvent sortir de la crise dans laquelle ils ont plongé la profession, je pense à ces années où je travaillais 90 heures par semaine, alors que j'avais une vingtaine d'années. Je le comprends aujourd'hui, contrairement aux années qui ont suivi la fin de cette époque et à la voie que j'ai trouvée ailleurs.
Des médias indépendants
Je n'ai jamais apprécié le terme “médias alternatifs”. Selon moi, il n'y a que des médias. Ils sont plus ou moins bons, plus ou moins intègres et plus ou moins fiables ; ils disposent de plus ou moins de ressources et ont une portée plus ou moins grande. Nos médias ont plus ou moins de pouvoir, selon les cas, et une place plus ou moins grande dans le discours public. Mais le terme “alternatif”, qui semble être apparu parmi les médias autres que les médias dominants eux-mêmes, est très mal perçu. Il relègue les médias alternatifs à un rang mineur comparé aux médias dominants établissant les normes, les consacrant ainsi en opposition perpétuelle à une version antérieure des événements. Ce n'est plus du tout le cas, si tant est que cela l'ait jamais été. Les meilleurs médias dits alternatifs sont aujourd'hui résolument pour - pour des vérités discernables, pour des comptes-rendus objectifs d'événements qui tiennent la route - des comptes-rendus qui, bien souvent, n'ont pas été publiés ailleurs.
L'expression “médias indépendants” est aujourd'hui la plus appropriée et la mieux acceptée - indépendants des entreprises propriétaires et des annonceurs, du pouvoir politique et institutionnel, des orthodoxies dominantes. Bien qu'il ne soit pas très répandu, je suis également favorable à l'expression “médias non alignés”.

Robert Parry, un réfugié du courant dominant lorsqu'il a fondé Consortium News en 1995, a exprimé ce point mieux que quiconque lorsque, 20 ans plus tard, il a accepté la médaille I. F. Stone pour l'indépendance journalistique de la Fondation Neiman. “Pour moi, la principale responsabilité d'un journaliste est d'avoir l'esprit ouvert à l'information, de ne pas avoir d'ordre du jour, de ne pas privilégier de résultat”, a-t-il déclaré à cette occasion. Il a ensuite ajouté le résumé que j'ai cité plus haut : “En d'autres termes, peu m'importe ce qu'est la vérité. Ce qui m'importe, c’est la vérité.”
Outre l'absolue dignité qui se dégage de ces propos, ils expriment implicitement l'idée que la place des médias indépendants a fondamentalement changé au cours des dix dernières années environ. Le tournant du courant dominant vers un journalisme dicté par l'agenda américain des années Trump et du Russiagate, si bien décrit par Jim Rutenberg [journaliste au New York Times] et les autres personnes citées, a été décisif, à mon avis.
Les médias des grands groupes exercent toujours une immense influence et continuent de compter de nombreux fidèles - il n'y a pas lieu de suggérer le contraire. Mais pour un nombre toujours croissant de lecteurs et de téléspectateurs, la servilité de ces médias à l'égard de l'État de sécurité nationale est nettement plus flagrante.
L'ensemble du journalisme grand public est désormais un “journalisme intégré”, car le champ de bataille est omniprésent. Cela impose aux publications indépendantes des obligations bien trop lourdes pour leurs moyens. Ne laissons pas ce facteur nous perturber. Il s'agit pour les journalistes indépendants et non alignés de comprendre les responsabilités qui leur incombent aujourd'hui et de les assumer avec conviction.
Les journalistes traditionnels ne créent pas souvent la première version de l'histoire, comme le veut l'adage, même s'ils l'ont fait ou non par le passé. À notre époque et, de toute évidence, à bien d'autres, le journalisme est la première ébauche de la présentation des choses que le pouvoir préconise afin d'exclure des livres d'histoire les reportages équilibrés et factuels sur les événements, ceux qui ont une incidence sur la conduite de l'empire sur le territoire national et à l'étranger.
Les journalistes en marge du courant dominant sont donc les véritables alliés de l'historien et assument le devoir de première ébauche que celui-ci exige. L'affaire du Russiagate en est la parfaite illustration. Alors que le courant dominant a accumulé les faussetés avérées et les conspirations farfelues, cette désinformation a peu de chances de survivre à l'examen minutieux d'un bon historien, étant donné le travail que les journalistes indépendants ont consigné à ce sujet. La tâche consiste à forcer l'indicible dans le discours ambiant. Cette tâche s'accomplit chaque fois que les journalistes parlent la langue qui n'est pas parlée, celle qui renferme la vérité. Voilà la tâche d'une presse réellement responsable.
L'appétit des lecteurs et des téléspectateurs pour ce genre de contenu est aujourd'hui indéniable. Cela confère également une responsabilité aux journalistes indépendants. Les lecteurs finissent par reconnaître ce que j'ai soutenu à plusieurs reprises dans mes articles : on ne peut plus lire le New York Times, et par extension le reste de la presse institutionnelle, pour être informé des événements, pour savoir ce qui s'est passé. Nous lisons le Times pour savoir ce que nous sommes censés penser qu'il s'est passé. Ensuite, nous partons à la recherche de comptes rendus exacts de ce qui s'est passé. N'y voyez aucune complaisance pour un esprit cynique. L'observation découle de nombreux cas où cette malheureuse réalité s'est effectivement vérifiée.
Je ne suis pas le seul à préconiser de reconstruire de fond en comble le métier, c'est-à-dire de rétablir le journalisme en tant qu'institution autonome, pôle de pouvoir, quatrième pouvoir, aussi désuet que ce terme puisse sembler.
Cette mutation doit s'accomplir sur une longue période, non pas à l'occasion de grandes conférences ou de symposiums savants, mais par le simple fait d'agir. Il serait insensé de compter sur les médias bien établis pour mener à bien ce processus. Il se peut qu'ils retrouvent le chemin de la subjectivité, qu'ils reprennent leurs esprits sur la question de la censure, ou qu'ils se sortent de leur étrange dérive vers le “wokery” et la “politique identitaire” dans leurs salles de rédaction.
Mais si l'on se réfère à l'histoire évoquée plus haut, il n'y a tout simplement aucune raison d'attendre des médias dominants qu'ils recouvrent une indépendance abandonnée depuis longtemps au profit de l'État de sécurité nationale - en tout cas, pas dans les conditions actuelles. Je ne décèle que de faibles signes de débat dans ces médias sur la question, de loin la plus décisive, car ils se refusent, comme ils l'ont fait pendant et après la guerre froide, à admettre leurs erreurs et leurs dysfonctionnements.
Chaque journaliste aujourd'hui en exercice est confronté à un choix auquel aucun d'entre eux n'a jamais été formé. “Si le journalisme vous évoque quelque chose”, a déclaré John Pilger lors d'une apparition télévisée au moment où j'écrivais ces lignes, “c'est que vous êtes un agent du peuple, et non du pouvoir”. C'est de ce choix dont je parle. Il a toujours été là, mais aujourd'hui, il est trop évident et trop criant pour qu'on puisse s'y soustraire. C'est grâce aux médias indépendants que les journalistes peuvent faire ce choix. Il n'y a que des médias, mais les plus indépendants d'entre eux sont destinés à revêtir une importance croissante.
* Patrick Lawrence, correspondant à l'étranger pendant de nombreuses années, principalement pour l'International Herald Tribune, est chroniqueur, essayiste, conférencier et auteur, dont le dernier en date est Journalists and Their Shadows. Parmi ses autres ouvrages, citons Time No Longer : Americans After the American Century. Son compte Twitter, @thefloutist, a été définitivement censuré.
Journalists and Their Shadows est disponible auprès de Clarity Press ou via Amazon ou Google Books.
Les opinions exprimées sont uniquement celles de l'auteur et peuvent ou non refléter celles de Consortium News.
https://consortiumnews.com/2023/09/04/patrick-lawrence-bad-faith-blank-checks/